« Un pognon de dingue ». Les propos d’Emmanuel Macron sur le système social curatif ont choqué. Au-delà de l’indignation, ces propos doivent être pris dans leur globalité et discutés dans leur cohérence.
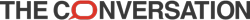
Il y a vingt ans, une grande loi fut promulguée en temps de cohabitation afin de lutter contre les exclusions. Cette loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions appelait dans son article 1er, l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale à participer à l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux. Sa mise en œuvre signa « un retour en force de l’aide et de l’action sociales (autrement dit de l’assistance) ainsi que le passage progressif d’une protection sociale assise sur l’activité professionnelle à une protection sociale reposant sur la citoyenneté ».
Cette loi mobilisatrice eut la force de dépasser les clivages politiques en appelant déjà à plus de prévention et de responsabilisation, mais en garantissant les droits et un accompagnement pour les plus précaires.
Une pauvreté qui s’étend
Or, les prestations sociales et l’accompagnement des plus précaires ne suffisent plus aujourd’hui à contenir la pauvreté comme le démontrent les chiffres d’un point de vue macro-économique.
Entre 2005 et 2015 (selon les dernières données de l’Insee), le nombre de pauvres a augmenté de 600 000 au seuil à 50 % du niveau de vie médian et d’un million au seuil à 60 %. C’est l’effet de l’accentuation des difficultés économiques liées à la crise financière. Si depuis 2012, le taux et le nombre de pauvres stagnent, cette stagnation est trompeuse.
La crise s’étend pour partie aux couches moyennes. Et le seuil de pauvreté est calculé en fonction du niveau de vie médian, or celui de 2015 est inférieur à ce qu’il était en 2011, ce qui impacte mécaniquement le taux de pauvreté.
Cette accentuation de la pauvreté sur longue période montre que le rôle de stabilisateur de la protection sociale s’essouffle en France comme ailleurs en Europe. Le maintien et parfois l’augmentation des prestations sociales (à des différences notables comme pour l’aide personnalisée au logement dont le montant a été revu à la baisse en 2018) ne permettent pas à la majorité des ménages, et pas simplement aux plus modestes, de s’en sortir financièrement. La hausse de prélèvements obligatoires et des charges fixes pèse à la baisse sur l’évolution des revenus.
Au-delà des données chiffrées, il faut également considérer le point de vue social, « tout ce pognon qui n’est pas dépensé ». En effet, les budgets sociaux ne sont pas toujours utilisés, loin s’en faut. C’est toute la question du non-recours aux prestations sociales.
Le montant des « non-dépenses » 10 fois supérieur à celui de la fraude
Revenons en 2011. L’évaluation du Revenu de solidarité active (RSA) a contribué à la mise sur l’agenda politique de la question du non-recours du fait de taux très élevés : 50 % pour l’ensemble du dispositif et 68 % en particulier pour le RSA « activité », la mesure phare du gouvernement de Nicolas Sarkozy censée maintenir dans l’emploi, par un complément de revenu, des « travailleurs pauvres », c’est-à-dire les personnes qui ont un emploi, mais dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté.
Or ce rapport d’évaluation a estimé à 5,3 milliards d’euros la non-dépense liée au non-recours, pour 7,5 milliards d’euros de versés cette année-là dans le cadre du RSA. Ces non-dépenses sont au moins dix fois supérieures au montant de la fraude sociale.
C’est également vrai en Grande-Bretagne à la même période. Le phénomène tend même à s’accentuer alors même que les discours sur l’assistanat et la fraude aux prestations sociales se renforcent. Ainsi en Grande-Bretagne, les sanctions accrues font qu’en 2016 moins d’un chômeur sur deux demande son indemnité.
En France le Défenseur des droits estime que
« La lutte renforcée contre la fraude aux prestations sociales, combinée aux erreurs de déclaration des bénéficiaires, véhicule la suspicion d’une fraude massive et peut s’avérer problématique pour les droits des usagers des services publics.
Et ce alors même que la fraude aux prestations sociales dans les branches maladie, retraite, famille et à Pôle emploi, ne représente que 3 % du montant total de la fraude détectée en France en 2015.
Avec le phénomène massif du non-recours en France comme dans d’autres pays (les taux de non-recours varient entre 40 et 60 % dans les pays de l’Union européenne), le problème du système social curatif n’est donc pas celui de sa dépense à perte du fait que « les pauvres restent pauvres ».
Ce système, complexifié au fil du temps, appelle en effet une amélioration car il n’atteint plus une population qui se bat avec plus de difficultés encore.
Pour en savoir plus : « Trop de pognon » dans les aides sociales ? La face cachée du non-recours
À quelle politique s’attendre ?
La question est de savoir à quelle politique s’attendre alors que la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté va être annoncée dans ses grandes lignes à partir du 9 juillet.
Une première réponse, radicale, est celle de la suppression des prestations sociales que l’on trouve toujours trop coûteuses et sans effet.
Elle a été mise en œuvre dans les années 1980 par Margaret Thatcher, avec la logique suivante : si tant de Britanniques ne recourent pas aux aides sociales, c’est bien la preuve que ces dernières et les services publics ne servent à rien.
Coupes budgétaires et suppressions furent ainsi inscrites au programme. Ce choix – réduire les crédits d’impôt et les aides aux ménages qui ont un emploi mais de faibles revenus, les aides aux chômeurs, limiter les dépenses en faveur de l’enfance et des jeunes, etc. – a été poursuivi par ses successeurs même si certains, tout en reprenant les orientations de leur aînée (dérégulation des services financiers ou privatisation du secteur public), ont pu redonner au cours de leur mandat un peu de moyens à des secteurs comme la santé ou l’éducation.
Ce choix qui a abouti à centraliser et fusionner les programmes d’emploi et d’assistance est à mettre en parallèle avec l’étendue et la progression de la pauvreté et des privations.
Or, cette réponse omet l’essentiel de la problématique : si les plus pauvres le restent, c’est d’abord par le manque de travail auquel aucune politique de l’emploi n’a su répondre.
Dans quel sens irons-nous en France ? Dans les deux minutes de la vidéo élyséenne, les mots employés semblent annoncer une autre couleur. Il faut « prévenir la pauvreté » et tout en même temps « responsabiliser les pauvres », mais aussi « investir dans un système social » qui évite de laisser les besoins en l’état pour dépenser plus ensuite.
La matrice du modèle social actif vers lequel tendent ces orientations s’inspire du « libéralisme égalitaire » qui défend à la fois, l’investissement social (dans la formation et l’éducation) pour réduire les inégalités des chances, et la responsabilisation des individus (suivant un gradient d’obligations et de sanctions) pour qu’ils se saisissent des opportunités mises à leur disposition de façon à éviter une supposée dépendance aux aides sociales.
Mesurer et croiser les données
Là est tout l’enjeu de la lutte contre le non-recours : prévenir le creusement des difficultés et l’accroissement des inégalités sociales, en même temps éviter d’alourdir à terme la facture sociale.
Cela demande pour commencer de se doter d’outils de mesure du non-recours. Des possibilités existent, elles attendent d’être développées. Les travaux de recherche sur le non-recours ont commencé par mesurer le phénomène à partir de bases de données administratives.
Cela pourrait être poursuivi et surtout généralisé dès lors qu’une volonté commune d’harmoniser et de croiser les données serait partagée.
En ce sens, le Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) créé en 2006 constitue probablement un outil propice du fait qu’il constitue un fichier interbranches et inter-régimes des assurés sociaux et bénéficiaires de la sécurité sociale.
Cela étant, outre des questions de cohérence statistique, la mise en œuvre d’exploitations régulières demande des moyens humains et financiers qui ne sont pas nécessairement garantis.
Identifier les situations de renoncement aux soins
Des organismes sociaux et des collectivités territoriales l’ont compris et mettent en œuvre des actions significatives en termes de repérage des situations de non-recours et d’intervention sur les territoires. L’action engagée par l’Assurance maladie depuis 2014 pour répondre au problème majeur du renoncement aux soins en est un exemple.
Ainsi divers acteurs (CCAS et services sociaux des villes et départements, mutuelles et organismes de prévoyance, missions locales et maisons de service aux publics, associations d’insertion et professionnels de santé…) se regroupent autour des CPAM dans le partenariat des Plateformes d’intervention départementale pour l’accès aux soins et la santé (PFIDASS).
Cela permet d’identifier largement les situations de renoncement à des soins. En effet, comme le rappellent les auteurs d’un article récemment publié dans les cadres des recherches pour l’Odenore, « plus 25 % des Français renoncent à se soigner ».
Cela permet aussi de réunir des moyens pour réaliser les soins manquants, dans le but d’éviter par la suite des « parcours de soins non optimaux » qui encombrent les hôpitaux et coûtent cher à la Sécurité sociale.
Les collectivités s’organisent
Pour éviter de dépenser « un pognon de dingue » qui laisse les gens dans les difficultés, les collectivités territoriales agissent également.
Elles jouent le partenariat et l’additionnalité des moyens pour cibler les populations et définir les réponses collectives les plus ajustées et durables. C’est habile puisque le partenariat et l’additionnalité sont deux principes incontournables pour accéder aux ressources des programmes financés par le Fonds social européen. Plus concrètement, les collectivités territoriales déploient à moyens constants des logiques de premier accueil inconditionnel au plus près des populations, mettent en place des guichets uniques voire des dossiers partagés avec d’autres institutions, etc. (voir l’article de l’auteur sur ce sujet à paraître dans la revue Horizons Publics).
Il s’agit de préserver l’indispensable proximité avec les populations qui décrochent de leurs droits et d’éviter les surcoûts induits par un passage anarchique au numérique et le creusement des inégalités sociales et des discriminations.
Si les collectivités sont fondées à intervenir en matière de politique de l’emploi, elles n’ont pas vocation à se substituer à l’État ou à Pôle emploi – elles n’en expriment d’ailleurs pas le souhait. En revanche pour appuyer l’action des Missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ou pour renforcer l’accompagnement individualisé proposé dans les Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, elles peuvent faciliter par exemple l’accès à des modes de garde ou à des moyens de déplacement. Par ailleurs, de plus ne plus de collectivités territoriales favorisent le développement social (écrivains publics, médiateurs pairs, médiateurs numériques) pour accompagner les personnes qui décrochent de leurs droits.
Ces acteurs locaux sont bien placés pour savoir que l’argent public ne peut pas être gaspillé. Ils investissent dans les solidarités en tenant compte de la réforme territoriale, de l’évolution de la fiscalité et des dotations budgétaires, et de l’accès aux financements européens. Les organismes sociaux interviennent alors que des réponses structurelles se font attendre, par exemple pour garantir l’accès aux soins et à la santé de tous (comme la généralisation du tiers-payant, la maîtrise du prix des consultations qui n’est pas prise en charge par l’assurance maladie obligatoire de base, etc.).
Si la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté relève de ces principes, on aura une idée du choix du Président. Le 29 juillet 2018, fêterons-nous alors l’anniversaire d’une loi qui aura su évoluer vers plus de solidarité ?
Déclaration d’intérêts : Philippe Warin est co-fondateur de l’Observatoire des non-recours aux droits et services (ODENORE)





















