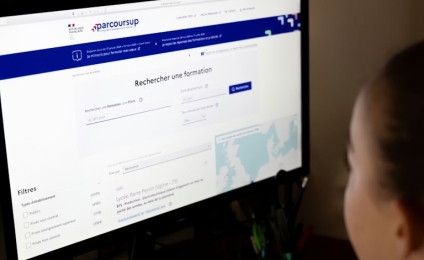Ce 14 janvier 2026, la Cour de cassation a écarté l’existence d’un « droit de correction » pouvant justifier les violences éducatives sur des enfants. Il n’existe pas de « droit de correction parental » dans la loi française, les textes internationaux ou la jurisprudence moderne, a-t-elle indiqué dans un communiqué de presse.
Alors qu’un père de famille avait été condamné en première instance en 2023 par le tribunal de Thionville à dix-huit mois de prison avec sursis probatoire et au retrait de l’autorité parentale pour des violences sur ses deux fils mineurs, la cour d’appel de Metz avait prononcé sa relaxe le 18 avril 2024 au nom d’un « droit de correction ».
Durant l’audience du 19 novembre 2025 à la Cour de cassation, la rapporteuse avait mis en avant que certains arrêts de la Chambre criminelle invoquaient certes un « droit de correction » parental, mais qu’ils étaient fort anciens, notamment l’un d’entre eux souvent évoqué en l’occurrence datant de 1819.
La plus haute instance judiciaire est donc revenue sur la relaxe qui avait indigné les associations de protection de l’enfance. Celles-ci avaient dénoncé un retour en arrière par rapport à la loi dite « anti-fessée » de 2019 qui avait abouti à l’inscription suivante dans le Code civil :
« L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. »
Le fait que la Cour de cassation ait dû réaffirmer cette inscription dans la loi nous rappelle que l’interdiction des châtiments corporels est le fruit d’une longue histoire et a rencontré de multiples résistances. Un certain nombre d’ambiguïtés apparues dès les débuts de l’école républicaine.