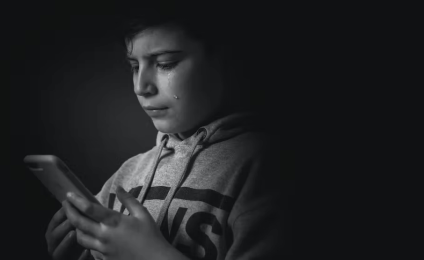L’assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020 est un événement sans précédent dans l’histoire éducative et politique de France : le meurtre prémédité d’un enseignant par un islamiste radical. Signe de l’ampleur du choc, cet acte terroriste a déjà suscité un grand nombre d’articles et de publications, centrés pour la plupart sur l’engrenage qui a conduit au drame, sur le travail policier et judiciaire qui a suivi.
Paradoxalement, les réactions des enseignants et de la communauté éducative en général ont été beaucoup moins traitées. Pour comprendre ce que la mort de notre collègue a signifié pour les acteurs d’une école touchée en son cœur même – l’acte d’enseigner – nous avons mené une enquête pluridisciplinaire (croisant sciences de l’éducation, histoire, science politique, sociologie), à la fois qualitative et quantitative, publiée en octobre 2024 sous le titre Une école sous le choc ? (éd. Le bord de l’eau).
Travailler sur cette question ne constitue pas qu’une simple étude. Cela renvoie aussi à nos propres vécus professionnels et à nos thématiques de recherches. Nous avons tous deux été enseignants d’histoire-géographie, appartenant à la même génération que Samuel Paty. En tant qu’universitaires, nous travaillions déjà, chacun de notre côté, sur différents sujets dits sensibles : les réactions du monde scolaire aux attentats de 2015, les rapports entre jeunes, religieux et système éducatif, ou les reconfigurations de la laïcité à l’école.