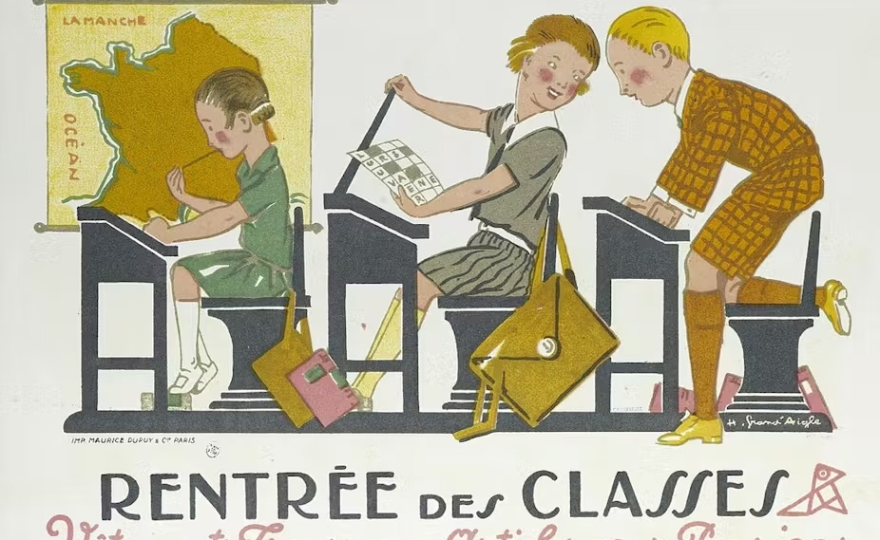Si les enseignants considèrent que notre système est laxiste et permissif, trop « bienveillant » pour les perturbateurs, les études disponibles nous apprennent que l’école française punit beaucoup, sans doute plus et plus sévèrement que dans les autres pays de l’OCDE. Les exclusions, en particulier, semblent s’y multiplier dans une logique inflationniste. Elles peuvent prendre toutes sortes de formes : ponctuellement pour une heure de cours, pour quelques jours du collège ou du lycée, ou plus définitivement lorsque l’on mobilise le conseil de discipline.
Autre paradoxe : la gestion de l’indiscipline est au centre des préoccupations des enseignants français, or il existe très peu d’études empiriques sur la punition. En clair, si celle-ci prend une place importante dans l’activité des professionnels de l’éducation et dans le quotidien des élèves, on y réfléchit peu et l’on sait peu de choses sur sa réalité factuelle.
Que peut-on dire alors de ces mesures d’exclusion de cours, de la manière dont on en vient à mettre un élève à la porte de sa classe et des effets de ces « renvois » sur les élèves, sur les enseignants et sur l’école en général ?
Alors que la ministre de l’Éducation nationale a lancé le 5 mai dernier une consultation nationale sur le respect de l’autorité, penchons-nous sur ce qui se joue dans ces pratiques banales dans l’enseignement secondaire à partir d’une recherche sur La fabrique quotidienne du décrochage.