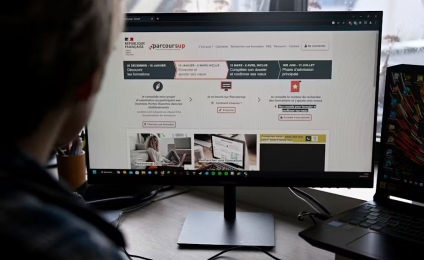Les aides publiques aux étudiants sont-elles adaptées et suffisantes ? La question revient régulièrement dans l’actualité. En 2014, 40 % des étudiants ayant leur propre logement étaient en situation de pauvreté monétaire.
La crise sanitaire, puis l’augmentation de l’inflation ont conduit à une progression de la précarité et du recours à l’aide alimentaire, et montré les limites d’un modèle d’aide aux jeunes reposant implicitement sur le soutien financier des parents. Neuf parents d’étudiants sur dix disaient en 2014 aider financièrement leur enfant étudiant par des dépenses ou transferts, pour un montant moyen de 1600 euros mensuels.
Le Conseil d’Analyse économique préconisait en 2021 de revaloriser et d’étendre les bourses pour faciliter l’accès à l’enseignement supérieur, en soulignant plus largement les effets bénéfiques des dépenses liées à l’enseignement supérieur sur la croissance.
À la suite d’une large concertation sur la vie étudiante, un rapport remis en juin 2023 au ministère de l’Enseignement supérieur a conduit à une augmentation du montant des bourses, ainsi qu’à la création d’avantages supplémentaires tels que des repas à 1 euro pour les étudiants boursiers.