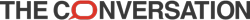La note à l’école fait régulièrement débat sous nos latitudes. D’un côté, on la condamne, car non seulement elle serait subjective, mais elle démotiverait les élèves, les humilierait, et servirait des finalités telles que la préservation des élites ou le maintien d’un pouvoir de l’enseignant sur sa classe.
De l’autre, on la plébiscite, arguant notamment qu’elle donnerait des messages clairs, participerait à encourager une émulation au travail et récompenserait les méritants.
Ces arguments, qu’ils soient représentatifs d’idées reçues ou issus de résultats de recherches, sont selon nous aujourd’hui devenus des poncifs qu’il s’agit de dépasser. Ultime déclinaison de cet affrontement, se demander s’il faut garder ou remplacer la note à l’école par un système alternatif est aujourd’hui un faux problème. Explications.
La notation est omniprésente
Aujourd’hui, on constate que, plus que jamais, la note EST. D’un point de vue sociétal d’abord, où nous ne comptons plus les domaines dans lesquels nous sommes soit amenés à noter quelque chose ou quelqu’un, soit nous nous retrouvons la cible d’une note. À ce niveau, citons notamment la Chine qui travaille à la mise en œuvre d’un système de notation de ses citoyens qui sera généralisé en 2020, ou les multiples exemples issus du monde du travail qui racontent les dérives de la notation des employés. Ce qui frappe dans ces situations, ce n’est pas tant l’existence de la note, mais bien davantage son mode de construction et son exploitation par les « évaluateurs » : sur quels critères se base-t-elle ? À quelles fins est-elle utilisée ? Rien n’est moins clair…
Dans le monde de l’école, nous observons qu’un mouvement similaire est en œuvre. La note se généralise également, y compris dans les systèmes scolaires désignés comme exemplaires, à l’instar de la Finlande. Ce n’est peut-être pas un hasard : de nombreuses études ont montré que les enseignants entretiennent avec la note une relation complexe, parfois paradoxale, où se côtoient une méfiance du chiffre qu’elle représente et un attachement à celui-ci. Alain Dubus, dans ses recherches, va même jusqu’à dire que :
« un enseignant qui ne noterait pas serait en danger de ne pas apparaître, y compris à ses propres yeux, comme un véritable enseignant, quelque chose comme un éléphant sans trompe ou un chien sans queue. »
Remplacer la note dans l’école traditionnelle par un système alternatif est donc peu réaliste, voire illusoire. En effet, nous observons que face à des codes de couleurs, des livrets de compétences ou à des appréciations verbales, les enseignants ont tendance, in fine, à fonctionner comme s’ils notaient (sur 6, 10 ou 20), en transformant leurs jugements ou appréciations en chiffres. Le problème se situe donc, à notre avis, dans un autre espace, secret, intime, idiosyncratique : celui des pratiques de notation des enseignants. Et il peut se résumer en une question, centrale : est-ce que supprimer les notes permettrait de rendre meilleures les évaluations ?
Pratiques de notation et pratiques d’évaluation
La réponse est pour nous clairement non. Par exemple, les diverses tentatives vécues en Suisse romande par exemple dans les années 90 et depuis ont montré les limites, voire l’échec d’un système qui remplacerait les chiffres par un autre symbole. En France, les débats engagés lors de la conférence nationale sur l’évaluation des élèves en 2014 n’ont pas encore permis d’aboutir à un consensus.
Et pourtant, une notation porteuse de sens existe. De nombreux travaux anglo-saxons menés dans ce champ depuis les années 60 ( !) fournissent des outils, des modèles théoriques et des perspectives pragmatiques pour mieux orienter les pratiques d’évaluation notées vers davantage de cohérence.
Ils montrent qu’il est possible de noter des élèves en référence à l’enseignement qui leur a été dispensé, au regard d’objectifs et de contenus clairs, au travers d’épreuves faisant sens, à l’aide de critères transparents communiqués à l’avance, et en évitant de recourir à des barèmes standardisés déconnectés de l’apprentissage réalisé en classe. Là, la note s’accompagne de commentaires centrés sur les apprentissages pour montrer ce qui est réussi et en voie d’approfondissement.
Des échelles descriptives précisent les niveaux attendus. L’élève est noté en référence à des repères pédagogiques et non en comparaison des scores de ses camarades ou d’autres facteurs aléatoires. Certes, un chiffre est toujours communiqué, mais la manière dont il est construit par l’enseignant est toute autre. À ces conditions, la note devient un outil pertinent parmi d’autres pour pronostiquer l’avenir scolaire de chacun·e.
Les travaux analysant de telles pratiques montrent que les biais connus de la note diminuent fortement. Les élèves comprennent mieux les règles auxquelles ils sont soumis. Leur motivation est moins mise à mal, et ils acceptent de manière plus claire leurs résultats puisqu’ils ont les moyens de les comprendre, même en cas d’échec. Certains chercheurs, comme Susan Brookhart, plébiscitent une note qui peut améliorer l’apprentissage.
Réorienter le débat sur la notation
Dans une telle perspective, l’enseignant doit considérer la notation comme faisant partie intégrante du processus évaluatif, et non comme une sanction en soi. Dès lors, c’est non seulement la note qui change de nature, mais tout le système d’enseignement-apprentissage-évaluation dans lequel elle s’inscrit. En effet, sa construction ne résulte plus de procédures mécanistes, mais devient une pratique d’une très grande complexité requérant des connaissances de haut niveau.
Or, ce qui ressort de nombreuses études (par exemple : Moss, C. (2013) et de nos propres recherches, (et c’est là une source d’inquiétude), c’est que la majorité des enseignants ne possèdent pas ces connaissances. La faute à des dispositifs de formation initiale et continue qui ont de la difficulté à prendre la mesure du problème, et à des politiques qui renvoient de plus en plus la question de l’évaluation aux épreuves externes et aux directions d’établissement pour lesquelles la note sert parfois avant tout à gérer les flux d’élèves.
Il y a donc urgence à réorienter le débat, en revisitant la formation des enseignants sur ce sujet et en interrogeant les rapports ambigus qu’entretiennent souvent les lois et les pratiques dans les écoles. Le travail est donc colossal.
Mais s’il n’a pas lieu, le risque est grand de reproduire encore pour longtemps le clivage stérile des « pro » et des « anti » notes qu’ont provoqué les premiers travaux d’Edgeworth aux Etats-Unis en 1888 et de Piéron en France en 1922. Nous devons maintenant être audacieux et nous poser de nouvelles questions : l’enjeu n’est ni plus ni moins de traiter différemment mais de manière plus pragmatique la question de l’égalité de traitement des élèves et de la lutte contre l’échec scolaire, toujours trop important dans une partie des états de l’OCDE. Il en va de la survie de toute société démocratique.