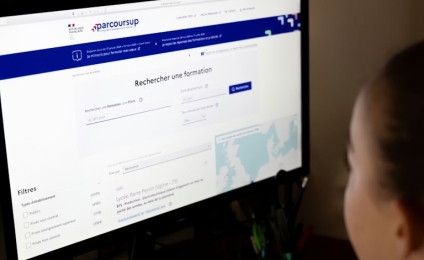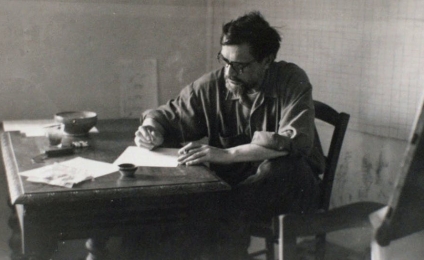Malgré leur diversité, les économistes de la santé s’accordent pour regretter l’organisation actuelle du financement des soins. Au cœur de la critique se trouve l’idiosyncrasie hexagonale : le financement par deux acteurs distincts du même panier de soins. Par exemple, la consultation chez le médecin généraliste donne lieu à un remboursement à hauteur de 70 % par la Sécurité sociale et de 30 % par la complémentaire santé (au tarif opposable).
Cette architecture est coûteuse et inégalitaire. En comparaison internationale, la France consacre une plus grande part de ses dépenses de santé aux coûts de gouvernance du système (Graphique 1). Ces derniers représentent 5 % du total des dépenses contre 4,3 % en Allemagne, 1,8 % au Royaume-Uni et 1,7 % en Italie. Seuls les États-Unis et la Suisse font moins bien. La raison principale de cette situation est la place occupée par les complémentaires santé. Alors que celles-ci sont responsables de la moitié des coûts de gouvernance, elles ne prennent en charge que 12,1 % des dépenses de santé.