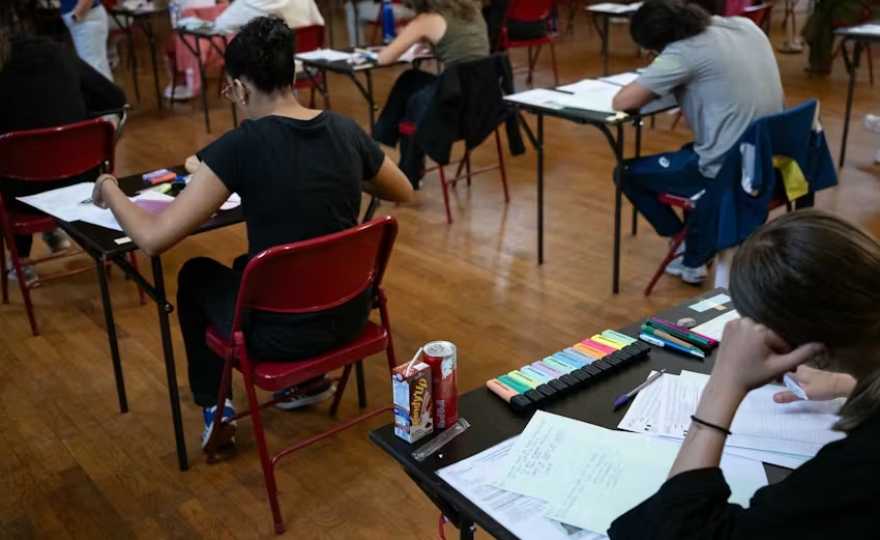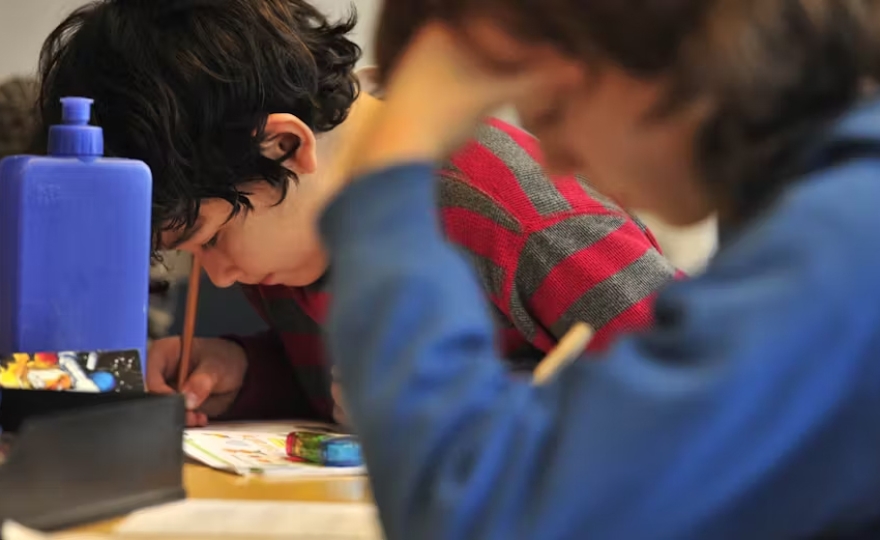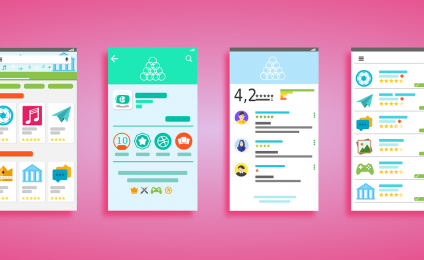Le volume de temps et d’engagement consacré « aux écrans » est une des caractéristiques de la culture juvénile actuelle. Si les parents sont animés de multiples craintes concernant les smartphones et autres dispositifs numériques, cette préoccupation n’est pas réservée aux Français. En Chine, où 97,2 % des adolescents ont accès à Internet, même dans les zones rurales, protéger et éduquer les jeunes au numérique constitue également un enjeu de société fondamental.
Or, le contrôle des usages à l’école en Chine est beaucoup plus strict qu’en France. La plupart des lycées chinois interdisent totalement le téléphone personnel. Pour les élèves d’internat, certains établissements proposent des boîtes fermées à l’extérieur des salles de cours pour garder les téléphones jusqu’à la fin de journée.
Au-delà des interdictions et des discours de prévention (la « pause numérique », le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, publié le 11 septembre 2025, sans parler des innombrables publications sur les « dangers des écrans ») ou de répression, pourquoi ne pas consulter les adolescents eux-mêmes ? Comment vivent-ils leurs expériences du numérique au quotidien ?
La comparaison entre la France et la Chine sur ce point peut être éclairante, au regard de la différence des contextes de contrôle. Dans le cadre d’une enquête de terrain qualitative conduite auprès de lycéens dans différentes villes de France et de Chine, nous avons pu donner la parole aux adolescents d’environnements sociaux très différents, non seulement sur leurs pratiques mais aussi sur leurs ressentis et sur leurs émotions.