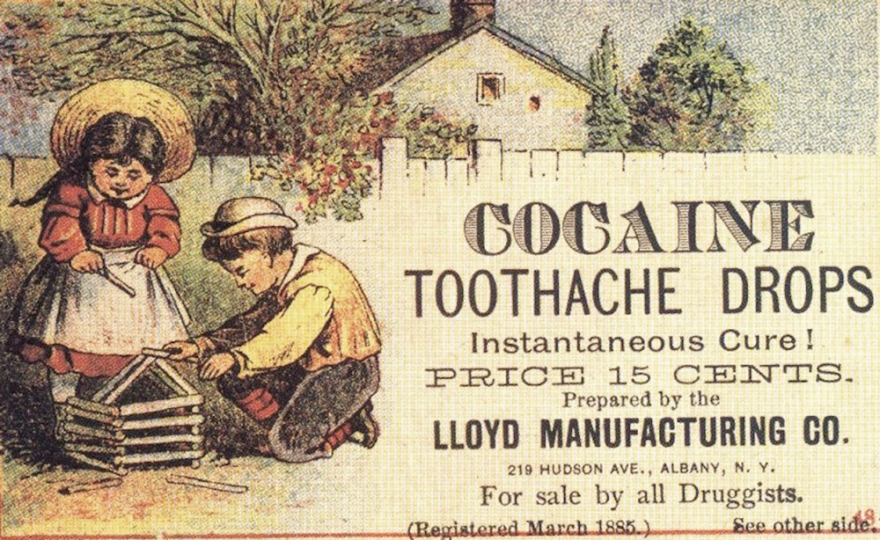La réflexion est venue d’un de mes étudiants en médecine, qui m’avoua qu’il adorait l’odeur de vanille qui régnait dans la maison qu’il partage avec des amis qui vapotent… « C’est bon, non ? » m’a-t-il demandé.
Ma réponse n’a pas été spécialement enthousiaste.
« Hé bien non. Si vous pouvez sentir la vanille, vous respirez aussi probablement de la nicotine… »
La nicotine est un alcaloïde (comme la caféine, la morphine…) toxique particulièrement vicieux car incolore et inodore. Il est de plus extrêmement bien absorbé par nos voies respiratoires, y compris le nez, la bouche, les bronches… et même les oreilles.
Et les fumeurs expirent non seulement de la nicotine mais aussi des produits chimiques absorbés à partir de leurs cigarettes, y compris électroniques. Il y a ces fameux arômes à l’odeur sucrée… ainsi que des particules fines et ultra-fines, divers composés chimiques (glycérol, formaldéhyde, etc.) spécifiques aux vapoteuses voire des métaux – mais pas de goudron ou de monoxyde de carbone.
Ceux qui les côtoient peuvent alors les respirer. Les défenses pulmonaires des fumeurs, des vapoteurs et de leurs voisins sont dépassées en cas d’expositions répétées.
Le vapotage est très répandu, chez les jeunes âgés de 18 à 24 ans notamment. Or, bien que les effets du vapotage sur la santé fassent l’objet de nombreux débats, les risques liés au vapotage passif et les conséquences sur la santé des non-fumeurs comme leur droit à respirer de l’air pur sont peu discutés.
Une étude menée en 2017-2018 a montré que 16 % des adultes, dans 12 pays européens, étaient exposés à des aérosols de cigarette électronique en intérieur – bars, restaurants, bureaux… (où la cigarette classique est bannie).