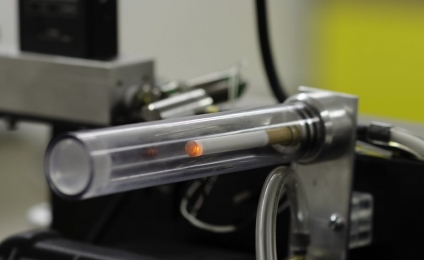Pendant la pandémie de Covid-19, de nombreux hommes et femmes de divers pays, parmi lesquels l’Inde,le Brésil ou le Royaume-Uni, se sont portés volontaires pour participer à des essais d’infection contrôlée. Lors de ces expérimentations, ces personnes en bonne santé ont accepté d’être intentionnellement exposées au SARS-CoV-2, le virus à l’origine du Covid-19, afin de comprendre comment se développe la maladie et comment elle se transmet.
Cette situation exceptionnelle a soulevé de nombreuses questions éthiques, non anticipées par les différents textes internationaux qui encadrent la recherche biomédicale. Dans l’urgence, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a mobilisé des experts qui ont émis plusieurs recommandations pour l’acceptabilité éthique des essais d’infection contrôlée portant sur le virus du Covid-19 chez des volontaires sains.
En France, le comité d’éthique de l’Inserm (Institut national français de la santé et de la recherche médicale) s’est aussi emparé de la question. Après une première étape ayant notamment consisté à analyser les raisons pour lesquelles les volontaires sains participent à des recherches parfois à risques, une initiative baptisée VolREthics (« Volunteers in Research and Ethics », ou Volontaires en recherche et éthique) a été mise en place.
Les travaux des experts impliqués dans ce consortium international ont abouti à la rédaction d’une charte visant à promouvoir les bonnes pratiques protégeant les volontaires sains dans la recherche biomédicale, à l’échelle mondiale.
Ce document est important, car, au-delà du cas très particulier de la pandémie, chaque année, des dizaines de milliers de volontaires sains sont exposés à d’autres types de risques liés à leur participation à diverses études. Voici ce qu’il faut en savoir.