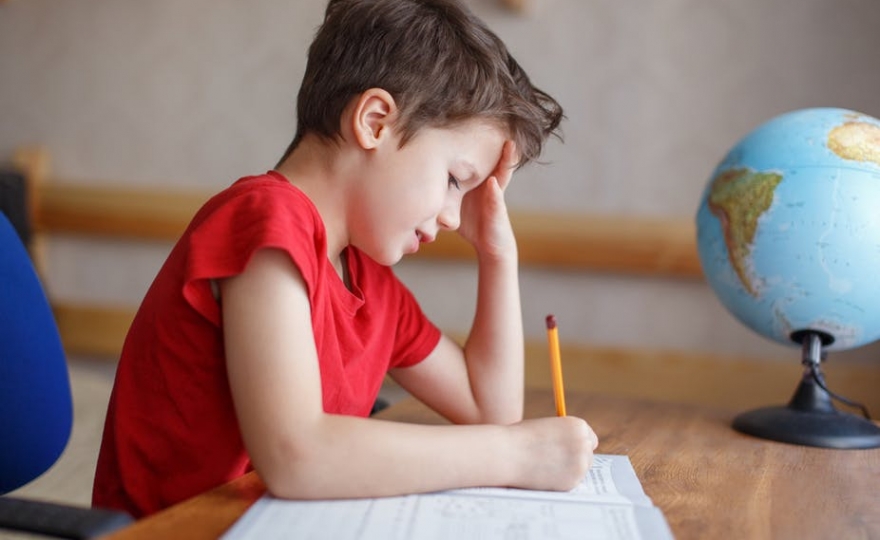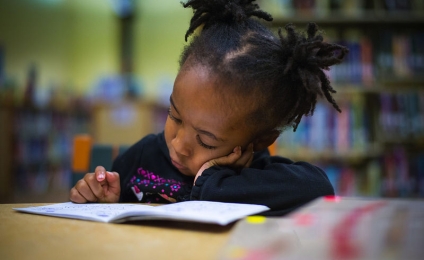Les écoles « différentes », c’est-à-dire celles dont le projet se situe dans la filiation des pionniers de l’éducation nouvelle (Freinet, Montessori, Steiner, Freire, Oury…), ont en commun la mise en œuvre de méthodes actives et une approche globale des savoirs ; il s’agit de partir des intérêts et des questionnements de l’élève, une approche globale des savoirs, le respect des rythmes de chacun, le développement de l’autonomie et la responsabilisation.
En France, ces pédagogies sont peu développées. Le contraste avec la situation d’autres pays est saisissant. On dénombre 22 000 écoles Montessori dans le monde, mais seules 296 écoles en France s’en réclament. Le mouvement Waldorf-Steiner compte plus de 3000 établissements sur les cinq continents, mais seulement 22 écoles françaises. La pédagogie Freinet serait pratiquée par 300 000 enseignants dans le monde, mais il n’existe que 21 écoles maternelles et primaires publiques « Freinet » en France.
Que ce soit dans le public ou dans le privé, en France, les écoles alternatives sont toujours restées minoritaires et à la marge des systèmes scolaires. Comment expliquer cette situation ?