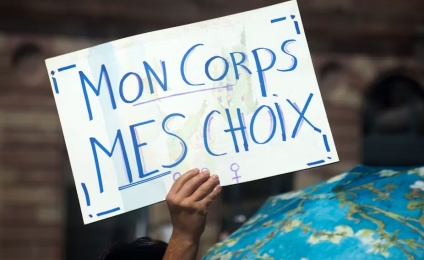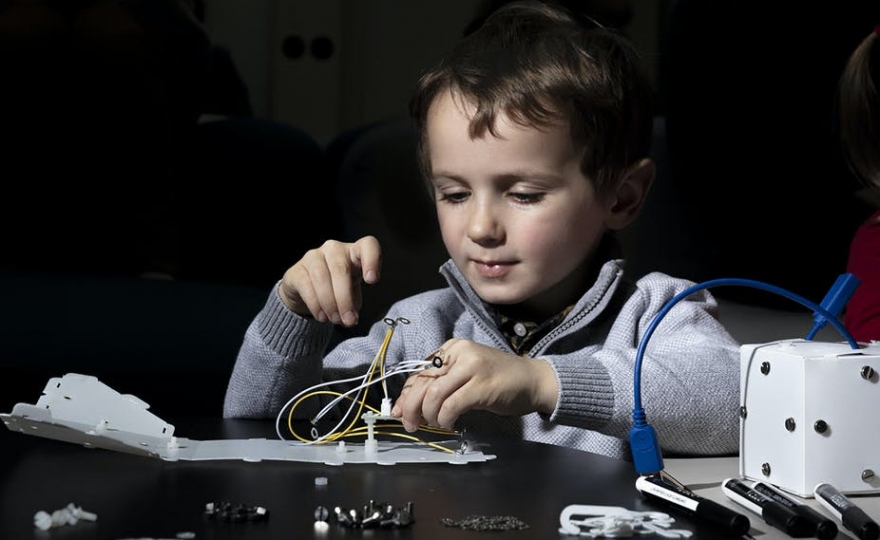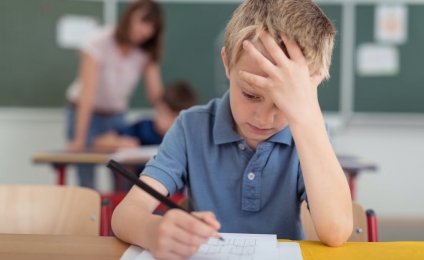La crise sanitaire déclenchée par la pandémie de Covid-19 a servi de révélateur à une crise bien plus ancienne et profonde : celle de l’hôpital public. Depuis 30 ans, progressivement, l’hôpital public a en effet basculé dans une nouvelle ère : celle de la « rentabilité ». Et pour réduire les dépenses, les gouvernements successifs ont lancé des dispositifs toujours plus contraignants comme le programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI), l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) ou la tarification à l’activité (T2A).
ACTUALITES
Faut-il voir l’art et la culture comme la chasse gardée des adultes ? Bien au contraire, ces domaines sont essentiels pour nourrir les pensées et les imaginaires des jeunes enfants, estime la psychologue Sophie Marinopoulos. L’idée est au centre de son rapport sur la santé culturelle des tout-petits, remis au Ministère de la Culture en août 2019. Non seulement cela participe à l’éveil du tout-petit mais cela rééquilibre également la relation entre parents et enfants, fortement perturbée ces derniers temps.
En effet, le confinement dû au Covid-19 a bouleversé les habitudes numériques des familles. Les règles intra-familiales sur l’utilisation des outils numériques par les plus petits se sont assouplies et, avec les grandes vacances, les questionnements se multiplient. Comment favoriser l’attitude active des enfants face au numérique ? Et si l’écran prend de plus en plus de place dans leur vie, comment en repenser les usages ?
L’inégale répartition entre les hommes et les femmes dans la prise en charge des tâches domestiques et familiales constitue la caractéristique toujours actuelle de l’environnement extra-professionnel des femmes.
Les femmes actives font face à une « double journée » de travail, c’est-à-dire qu’elles cumulent dans une même journée obligations professionnelles et familiales/domestiques. Or de nombreux travaux francophones ont montré la difficulté à articuler travail professionnel et travail domestique pour les femmes.
En cela, les horaires flexibles peuvent être considérés a priori comme un moyen de mieux organiser le « temps de travail » des femmes (c’est-à-dire la somme des temps de travail professionnel et domestique) et ainsi leur difficulté à concilier vie professionnelle et vie privée.
Le système de contrat en alternance a été mis en place afin de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants et de garantir une plus grande égalité des chances dans la recherche d’un premier emploi.
Ce système, qui permet de combiner enseignement théorique et expérience professionnelle au sein d’une entreprise, concerne aujourd’hui plus de 500 métiers du niveau CAP à Bac+5 et notamment les formations en management.
La crise économique que nous connaissons actuellement fragilise les comptes de nombreuses entreprises qui se retrouvent dans l’obligation de procéder à des coupes budgétaires pour se maintenir à flot. L’emploi des jeunes en ressort alors grandement menacé.
En France, avant 2002, tout chômeur qui lançait son entreprise perdait automatiquement ses droits aux allocations chômage, quand bien même il ne tirait que peu de revenus de son activité entrepreneuriale. Par ailleurs, s’il décidait d’arrêter son entreprise, celle-ci ne s’avérant pas rentable, il n’avait pas droit au reliquat de droits aux allocations.
Ces règles constituaient ainsi un frein à la création d’entreprise.
C’est pourquoi la France lançait en 2002 une réforme à grande échelle du système de l’assurance-chômage connue sous le nom de « Plan d’aide au retour à l’emploi (PARE) ».
La modification des règles a permis à tout chômeur devenu entrepreneur de continuer à percevoir des allocations de sorte à compléter les revenus tirés de l’entreprise jusqu’à concurrence des prestations complètes qu’il aurait perçues s’il était resté au chômage. Le système perdure jusqu’à ce que l’entreprise devienne rentable ou que la personne épuise ses droits. De plus, si elle arrête son activité dans les trois ans, elle a droit aux allocations restantes.
Dans une étude publiée en juin dernier, nous étudions l’impact de cette réforme qui visait à favoriser la création d’entreprise par les chômeurs. Nos résultats indiquent qu’une assurance-chômage bien conçue constitue une aide à faible risque et permet de stimuler l’entrepreneuriat.
Combien vaut une vie sauvée ? Et pourquoi une telle question, qui peut sembler provocatrice ? Car si certains arguent que « la vie n’a pas de prix », d’autres répondent qu’elle a cependant un coût, et notamment celui qui est investi dans les services de secours quand il s’agit de mettre en œuvre d’onéreux moyens pour la sauver.
De là à évaluer la qualité de nos services publics à l’aune de leur fonction économique dans la société, il n’y a qu’un pas qu’il convient d’étudier avant de le franchir.
Il se trouve que l’évaluation (et la méthode pour ce faire) de la valeur d’une vie en termes économiques peut grandement varier en fonction de l’objectif que cette évaluation poursuit : obtenir ce chiffre n’a que peu d’intérêt intrinsèquement, car la réponse paraîtrait toujours absurde.
Cependant, lorsqu’il s’agit d’évaluer financièrement le retour sur l’investissement que l’État et les collectivités confient aux services de secours, l’intérêt est de pouvoir juger sur des données factuelles la pertinence de cet investissement. C’est le projet dans lequel nous nous sommes lancés avec les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône.
Métiers du Social
Catégories d'actualités
Articles populaires
- Référentiel professionnel éducateur spécialisé 2018
- Exemple d'ISAP dans un CCAS
- Référentiel professionnel éducateur de jeunes enfants 2018
- Méthodologie et trame de l’ISAP au DPP d'Assistante de Service Social
- Décret n° 2018-734 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail social
- Référentiel professionnel Assistante de service social 2018
- A-t-on le droit à un remboursement du psychomotricien par la mutuelle ?
- Référentiel professionnel Conseillère en économie sociale familiale 2018
- Les cinq substances les plus addictives au monde et leurs effets sur le cerveau
- Réforme Formation Préparation Concours ES ASS EJE CESF ETS
- Qui a peur de l’éducation à la sexualité ?
- Addictions chez les jeunes : la solution est dans la relation éducative
- Référentiel professionnel Éducateur technique spécialisé 2018
- Ecoles de formation en travail social : Ile de France
- Reprendre le travail après un burn-out, un long cheminement émotionnel
- L’incompétence professionnelle et sociale, première cause d’une mauvaise ambiance de travail
- Derrière l’arbre de la « transformation », la forêt des innovations managériales
- Oubliez tout ce que vous savez sur les assistantes sociales - Saison 3
- Désengagement des salariés au travail : un éclairage, et des pistes de solution, fondés sur la qualité des relations client-fournisseur
- Autisme : comment on veille sur la santé des enfants qui ne parlent pas

Le Social est édité par la société Social Connexion. Son équipe propose des services en ligne depuis plus de 25 ans dans le domaine du secteur social et du médico-social.