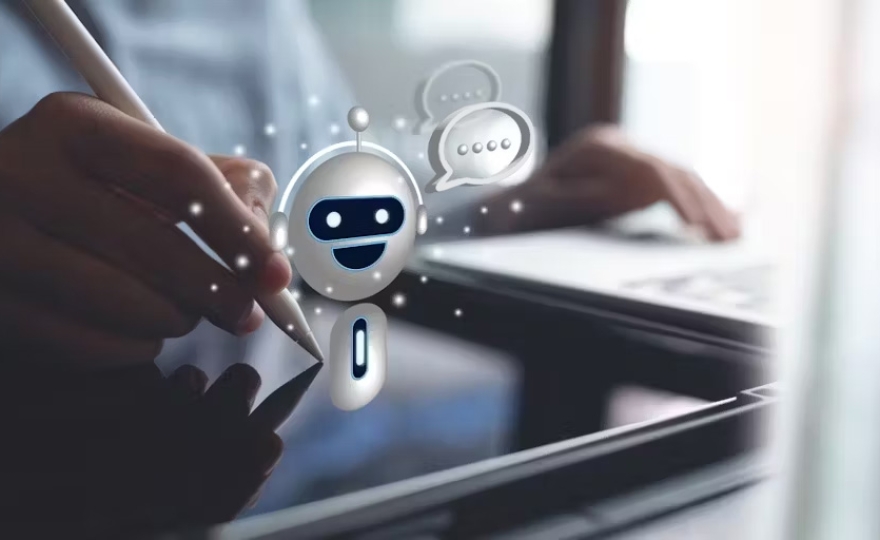Le féminicide est le meurtre d’une femme parce qu’elle est une femme. Cette définition voit le jour sous la plume de la sociologue Diana Russell qui, après avoir travaillé à identifier cette forme spécifique de violence dans les années 1970, signe en 1992 avec sa consœur Jill Radford l’ouvrage fondateur, Femicide: The Politics of Woman Killing (New York, éditions Twayne).
D’abord approprié par les chercheuses et militantes d’Amérique latine dans les années 2000, le concept se diffuse lentement en Europe à partir des années 2010. En France, il faut attendre les premiers comptages du collectif Féminicides par compagnon ou ex (2016) et le début des collages féminicides, en 2019, pour que sa diffusion soit assurée à l’échelle nationale.
Pourtant, ni le féminicide comme fait social ni sa dénonciation ne sont des nouveautés. Depuis le XIXe siècle, des militantes féministes tentent d’identifier et de théoriser ce crime. Mais leurs idées sont demeurées minoritaires (ou plutôt minorisées) et, faute de trouver un écho dans l’opinion, sont restées méconnues.
Un travail de dévoilement généalogique de la notion, couplé à l’analyse d’affaires judiciaires, permet de saisir les biais sociohistoriques qui ont entravé l’émergence de ce concept clé. Il permet également d’identifier les marges de progression qui demeurent dans la lutte contre cette forme de violence extrême contre les femmes.